Depuis plusieurs semaines, mon jardin est laissé en jachère. Si le jardinier s’en est absenté, c’est pour cultiver un autre jardin plus intime, où la végétation est encore en gestation. Parfois le site, ce “jardin public”, en montre des reflets, parfois ce n’est pas possible tout simplement parce que je ne saurais pas en communiquer le contenu sans en déflorer l’essence. Ce jardin intime ressemble alors davantage à l’effervescence vitale qui anime le sous-bois d’une forêt primordiale, qu’au jardin stylisé, oeuvre d’un jardinier aguerrit. Plusieurs projets m’animent quotidiennement depuis de nombreux mois.
I/ Des projets en gestation
Le premier, le plus ancien, gravite autour de la figure de René Passet. Depuis plusieurs années, son oeuvre économique m’inspire et donne du sens à cette discipline tellement méconnue et décriée. Incomprise, prisonnière des préjugés, rares sont les économistes ayant droit à la scène médiatique qui ont su lui donner des lettres de noblesse. Passet en fait parti, même si aujourd’hui, il est retombé dans l’ombre pour un large public. Grâce à lui j’ai rencontré d’autres figures qui développent une vision très intelligente de cette discipline et de son rôle dans l’ensemble des savoirs humains. Si la biographie que j’ai consacré à René Passet est aujourd’hui achevée dans ses grandes lignes, il me reste encore à travailler pour l’insérer dans la tradition intellectuelle à laquelle René Passet appartient. Cette appartenance n’est d’ailleurs pas unilatérale, il en existe plusieurs dont j’éprouve aujourd’hui de la difficulté à en donner une vision claire. Il y a les appartenances qui se découvrent rapidement lorsqu’on s’intéresse à lui comme la parenté avec les réflexions de Jacques Ellul, celles de François Perroux ou le brassage intellectuel qu’ont mis en oeuvre les diverses personnalités du “Groupe des Dix”. D’autres appartenances se révèlent de manière beaucoup plus diffuse comme l’oeuvre de Pierre-Louis Reynaud, ou celle d’Henri Bartoli par exemple. Bartoli avec qui Passet nourrissait une grande amitié. Enfin il y a les appartenances qu’il inspire… Elles sont légions parce que la fréquentation des travaux de Passet ne cesse de féconder mon imaginaire. Bien qu’il s’en défende parce qu’il a émis à leur encontre des critiques communes aux milieux universitaires francophones, il existe à mon sens une parenté évidente entre son oeuvre et les réflexions de la “deep ecology”. Cette appartenance s’articule autour de la profonde intégration que Passet révèle entre le fonctionnement de la biosphère telle qu’il apparaît dans les observations des systémiciens, et le fonctionnement de la complexité économique telle qu’elle se manifeste lorsque l’on accepte de ne point se laisser enfermer dans la conceptualisation trop étroite et close sur elle-même que les économistes produisent habituellement. Mais, il existe aussi une divergence au niveau des implications éthiques que fait émerger cette compréhension. Alors que les penseurs de la “deep ecology” cherchent les voies d’un “lâcher-prise” permettant à la nature d’épanouir ce qu’ils appellent “wilderness”, un caractère sauvage, indompté, libre de la gestion “rationnelle” des humains, Passet demeure assez proche d’un anthropocentrisme dont il se réclame d’ailleurs ouvertement. Il est normal pour lui que l’homme voit la nature au travers du prisme de sa propre inscription dans le monde. Son point de vue pourrait soulever cette question: n’est-ce point déraper vers un orgueil démesuré que de prétendre adopter un point de vue capable d’embrasser toutes les formes de vie? A mon sens, il s’agit d’un orgueil si ce point de vue vise à s’imposer comme le seul qu’il soit sain d’adopter, en revanche s’il ne convertit que celui qui en est le porteur, intimement pénétré de l’interdépendance générale qui unit, au sein de son expérience, toute manifestation, alors cette attitude révèle au contraire une profonde humilité, déprise de toute prétention, libre de toute velléité prosélyte. L’autre appartenance à laquelle René Passet n’a pas énormément consacré de pages, mais dont je pense qu’il s’est abondamment nourri, est l’ensemble des réflexions épistémologiques sur les aspects systémiques (ou complexes) des sciences en général et de l’économie en particulier. Il ne s’en cache pas, mais contrairement à Edgar Morin ou à Henri Bartoli, René Passet n’a pas produit véritablement une oeuvre philosophique, il a spontanément écrit avec cette sensibilité à la complexité, mettant en pratique les réflexions théoriques d’autres penseurs. Pour l’instant, mon travail sur l’oeuvre de Passet me demande encore de mûrir certaines réflexions pour que je puisse en proposer une lecture qui, tout en étant fidèle à l’intention de son auteur, me soit personnelle, témoignant ainsi d’une certaine clairvoyance, d’un certain discernement, dont je lui suis redevable. Passet propose en effet de redéfinir les problèmes que rencontre l’humanité, en les graduant sur une échelle d’importance qui permet de porter son regard sur l’urgence et de trouver des solutions pérennes pour nos enfants.
L’autre projet sur lequel je travaille avec d’avantage d’inspiration actuellement, est la rédaction du cours de “Religions et civilisations”. A la rentrée 2010, cela fera la troisième année consécutive que l’Itech m’offrira la possibilité de partager avec les étudiants des réflexions sur le sens que les religions, et notre engagement au coeur de leurs enseignements, peut donner à nos vies. Jusqu’à maintenant, mes cours s’organisaient autour de diaporamas, de notes éparses et de documentaires qui illustraient mes propos. Cette année, il m’est apparu qu’il serait beaucoup plus riche de travailler à l’élaboration d’un contenu dont les étudiants puissent disposer à leur convenance. Le “Jardin de Pierre” avait déjà cette vocation, mais il n’y était pas entièrement dédié. Cela en voilait parfois l’accès. Ce travail de rédaction m’est d’abord apparu nécessaire alors que je lisais des textes magnifiques qui d’évidence émergeaient de l’expérience inspirée de leurs auteurs. J’ai souvent eu envie d’en partager la saveur avec les étudiants. En omettant d’en prendre note immédiatement, je laissais alors au temps la possibilité d’en effacer les traces, et de laisser l’oubli en soustraire la lecture aux étudiants. Il en était de même de tout un ensemble de réflexions qui parfois émergeaient puis s’évanouissaient comme les rêves au matin, si je ne prenais pas soin d’en noter le contenu lorsqu’il se présentait spontanément à mon esprit. Aujourd’hui la rédaction du cours s’élabore lentement sans que je sache encore vraiment où elle me mène. Cette incertitude, loin d’être pesante, est au contraire assez gratifiante parce qu’elle diffuse dans l’élaboration de ce cours, un sentiment de liberté que j’ai rarement éprouvé dans ce genre d’exercice.
2/ Une rencontre longuement attendue
Mais ce long préambule m’éloigne de mon propos initial. Je souhaitais aujourd’hui enrichir le contenu du “Jardin” d’une rencontre. J’ai souvent écrit que l’achat des livres d’occasion était une activité gratifiante parce qu’elle est le lieu de rencontres fortuites qui peuvent se révéler essentielles. Mais ces rencontres ne sont pas toujours placées sous le signe d’un apparent hasard. Certaines sont de longue date attendues. Tel est le cas du livre d’Elisabeth de Fontenay, Le silence des bêtes. La philosophie à l’épreuve de l’animalité paru chez Fayard en 1998.
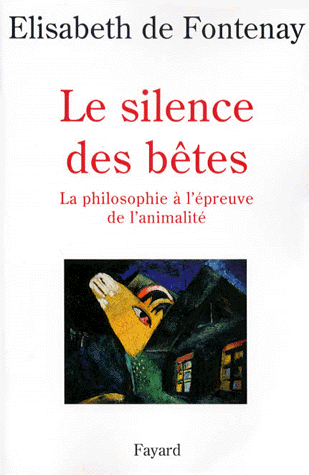
Un livre dense, d'une profonde intelligence, exigeant pour son lecteur.
J’ai longuement attendu qu’une personne me le transmette par l’intermédiaire du Service Achat Occasion. Je savais que Mme de Fontenay avait produit avec ce livre une réflexion profonde que beaucoup considèrent comme une référence incontournable en la matière. J’ai toujours ressenti beaucoup de frustrations en lisant les réflexions que mes semblables consacrent aux animaux. Tout se passe comme si cette réflexion était tronquée: soit on considère dans le sillage de Descartes que les animaux sont des machines, ou bien des vivants dont l’instinct ressemble aux programmes qui régissent le fonctionnement d’un ordinateur, soit on s’intéresse à leur sensibilité et rapidement les réflexions dérives vers un “nivellement éthique” de toutes les formes de vie. Très rapidement, celui qui s’intéresse à son appartenance au monde des vivants, à sa famille humaine, puis à ses parents plus éloignés comme les singes, puis les mammifères jusqu’aux formes les plus éloignés de notre identité actuelle, se trouve emprisonné dans ces deux alternatives, aussi aliénantes l’une que l’autre.
En réalité, il existe de passionnants travaux qui y échappent: je pense notamment aux travaux du biologiste Jacob von Uexküll dont l’oeuvre allemande n’a malheureusement pas été traduite en français, hormis Mondes animaux et mondes humains et sa Théorie de la signification. Tout l’intérêt des travaux de Uexküll réside dans le fait qu’il a une approche phénoménologique de la perception animale. Pour lui, l’animal est un sujet connaissant avec ses propres capacités perceptives et cognitives. Il est malheureusement ignoré d’un large public et, à ma connaissance, aucune étude en langue française ne lui est consacrée.
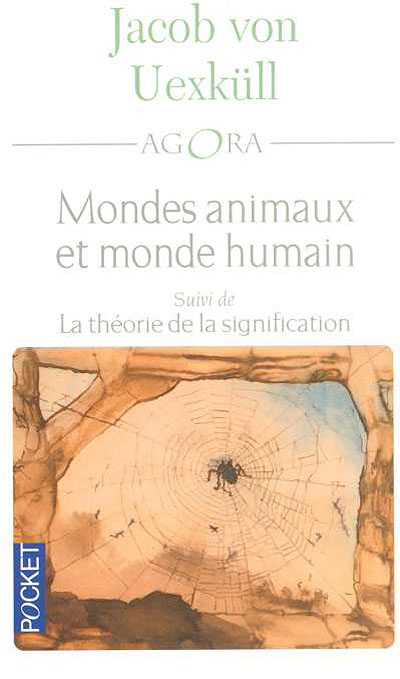
La phénoménologie appliquée à l'éthologie
L’autre travail très intéressant porte sur les chimpanzés, il est dû à Roger Fouts et Stephen Tukel Mills qui relatent leurs travaux dans un livre intitulé: L’école des chimpanzés paru aux éditions J’ai lu. Dans ce livre, les auteurs expliquent que non seulement les chimpanzés sont capables d’apprendre quelques gestes essentiels du langage des signes utilisés par les malentendants, mais qu’ils sont également capables de les associer pour produire des phrases signifiantes, et même de les transmettre à leurs enfants. Edgar Morin fait référence à ces travaux dès les années 70.

Un témoignage riche d'enseignement sur la continuité entre les aptitudes des chimpanzés et des humains
Le livre d’Elisabeth de Fontenay ne se place pas dans les points de vue des biologistes ou des éthologues, elle questionne les philosophes. Et force est de constater qu’en la matière, la plupart des philosophes qu’on a coutume de placer sur un piédestal, comme s’ils étaient des phares incontournables pour celui qui veut penser de manière juste, se révèle bien pauvre, complètement myope dans la vision qu’ils proposent des animaux. Ce que constate Mme de Fontenay, c’est qu’avec l’avènement du christianisme en occident, les penseurs n’ont eu de cesse de tenter de “verrouiller le propre de l’homme”. Comme si cette division au sein du vivant était la seule voie saine. Peut-être pourrait-on penser qu’on a déjà tant de mal à s’entendre entre nous, entre membres d’une même famille, entre conjoints, entre frères et soeurs, entre membres d’un même village, d’une même ville, d’un même pays et aujourd’hui entre membres de la communauté humaine toute entière, tant de difficultés donc… qu’il serait bien vain de prétendre encore élargir nos liens de parenté à la famille de tous les vivants! Pourtant, Elisabeth de Fontenay, à la suite de Michelet et d’autres penseurs occidentaux minoritaires, n’hésite pas à montrer toute l’ignorance que révèle une telle compréhension. Notre rapport aux animaux conditionne notre rapport à l’humanité, notamment l’humanité que l’on considère comme tout autre, l’humanité des infirmes, des malades mentaux, de la vieillesse et de tout son corollaire de décrépitudes. Courageusement, elle explique que trois soucis l’ont accompagné tout au long de la rédaction de cette oeuvre monumentale (800 pages composées de petits caractères):
- “une particulière tendresse pour les animaux, cela va de soi”.
- “la mémoire de la destruction, par millions, d’hommes, de femmes et d’enfants. Et, par dessus tout, une réelle impuissance à définir un quelconque propre de l’homme.” C’est pour Mme de Fontenay, “l’une des seules évidences qu’autorise notre époque dans son épuisante équivocité”.
- enfin, elle confie à son lecteur qu’il “peut arriver à quelqu’un, témoin et partie prenante d’une maladie de l’esprit qui a frappé son sang, de trouver un jour dans le vacillement même du malheur la bonne distance, celle qui lui permette d’accueillir la fatalité tombée sur un enfant des hommes, pour réfléchir désormais au destin donné en partage à ceux qu’on tient pour seulement vivants”.
Rappelons simplement qu’Elisabeth de Fontenay a vu une partie importante de sa famille périr dans les camps de concentration. Aussi peut-elle affirmer dès la première page de son livre qu’”aimer et respecter les animaux ne conduit pas à la misanthropie, au racisme ou à la barbarie”, de même qu’elle peut souligner que “les pratiques d’élevage et de mise à mort industrielles des bêtes peuvent rappeler les camps de concentration et même d’extermination”, ce qui n’enlève rien au caractère singulier de la destruction des Juifs durant la seconde guerre mondiale.
Le livre d’Elisabeth de Fontenay m’a été transmis par une dame qui souhaitait ardemment le lire lors de sa parution. Elle n’a pu le faire que partiellement, parce qu’il s’est révélé parfois d’une grande complexité. Elisabeth de Fontenay est philosophe de formation, bien qu’elle ne s’interdise pas d’écrire sur le ton de la confidence, elle use avec dextérité de la technicité du langage, et n’hésite pas à enrichir son propos de nombreuses notes de bas de page. Il s’agit d’une oeuvre qui s’est construite dans la durée. Elle a besoin d’être lue avec la même patience. Il s’en dégage une noblesse de réflexion qui m’émeut grandement, et qui donne aux autres engagements de Mme de Fontenay (mouvement “La Paix Maintenant”), un parfum de santé et d’authenticité indéniable.
Enfin, avant de clore cet article, je souhaitais également inviter les lecteurs à consulter un très beau livre, emprunt d’une grande poésie. Il s’agit d’une oeuvre écrite par Shabkar, un yogi errant, qui vécut au Tibet durant le XIXème siècle. Figure emblématique du mouvement Rimé, mouvement non-sectaire qui revivifia toutes les branches de l’enseignement du bouddha, et même de la tradition Bön, Shakbar a composé de nombreux ouvrages dont le zèle des traducteurs et pratiquants français nous permet aujourd’hui de bénéficier, tout au moins en partie. Padmakara a publié en 2005, Les larmes du bodhisattva. Enseignements bouddhistes sur la consommation de chair animale qui donne à toute cette question un éclairage traditionnel tout à fait passionnant, d’autant plus qu’il n’appartient pas à la sphère occidentale de l’humanité.

Un enseignement sur nos comportements en matière alimentaire
