La complexité géopolitique
Quoi de plus complexe que la géopolitique ? La physique quantique peut-être, on peut raisonnablement le penser. Mais imaginons que vous puissiez rencontrer quelqu’un qui soit en mesure de vous l’expliquer simplement, comme si l’on pouvait expliquer les logiques à l’œuvre dans le monde microphysique aussi simplement que l’attraction terrestre avec la chute d’une pomme. Ne serait-ce pas un émerveillement ?
Dominique Moïsi serait-il donc un magicien, ou mieux un enchanteur ? Pour vous dire la vérité j’ai toujours rencontré beaucoup de difficulté à comprendre les multiples relations qui se nouent entre les gouvernements. Quels sont les grandes lignes des relations internationales ? Quelles sont les motivations des États lorsqu’ils adoptent telle attitude plutôt qu’une autre ?
La raison de cette difficulté est simple. C’est justement la richesse des liens que tissent entre eux les pays qui me rend si difficile la compréhension des enjeux réels. Et cette difficulté est malheureusement incontournable. Alors où est-il cet enchantement me direz-vous ?
La place des émotions
Dominique Moïsi ne gomme à aucun moment cette complexité propre à la géopolitique, mais il réintroduit une approche qui était tombée en désuétude au XXème siècle. Et il se pose la question bien légitime de la place des émotions dans la conduite des affaires du monde. Si au niveau individuel, chacun sait en son for intérieur l’importance que les émotions vont jouer sur ses relations avec les autres, à un niveau plus global le silence tant des théories que des commentateurs est éloquent.
Autrefois il n’était pourtant pas rare de rencontrer sous la plume des historiens, une description de la mentalité des peuples. Bien sûr ces descriptions étaient le plus souvent déformées par une vision ethnocentrique, amoindries par un complexe de supériorité. Les seuls récits fiables, quoique n’ayant pas la prétention à fournir une explication d’ensemble, mais plutôt une fidèle description, étaient ceux des voyageurs et des premiers ethnologues désireux de « goûter » sans préjugé la richesse de la nature humaine.
Dominique Moïsi dans son livre La géopolitique de l’émotion renoue avec cette tradition humaniste qui s’émerveille de la diversité des comportements humains et voient par delà les différences, la profonde unité qui nous (noue) relie les uns aux autres tant sur le plan individuel, qu’au niveau des nations entre elles. Il choisit, avec son expérience de membre fondateur de l’Institut Français des Relations Internationales et d’éditorialiste au Financial Times, aux Echos et à Ouest France, d’apporter un éclairage personnel et, me semble-t-il, pertinent sur les motivations émotionnelles qui sont à l’œuvre actuellement dans le monde.
Vivre ensemble implique une certaine confiance, confiance dans la capacité du groupe à nous soutenir dans notre vie, à nous apporter confort et réconfort. Dès sa naissance, et même avant, l’homme est une espèce sociale. L’individu si choyé par nos approches individualistes contemporaines est d’emblée social. Nous vivons neuf mois en symbiose avec notre mère et naissons complètement immatures, en ayant besoin du soin de nos semblables durant de nombreuses années pour devenir autonome.
L’espoir
Lorsque cette confiance est honorée nous habitons dans l’espoir. Hier était un pays où nos attentes ont été comblées, où l’inattendu s’est révélé fécond, demain sera donc porteur des fruits de ce passé. Mais l’espoir n’est pas seulement la réponse mécanique ou nostalgique à un passé heureux, il peut l’être également d’un passé houleux, et à ce moment là, demain ne peut être pire qu’hier. Certaines nations sont actuellement caractérisées par cette émotion dominante. L’Inde et la Chine sont les grandes nations chez qui Dominique Moïsi repère l’espoir.
« Si la Chine est consciente de ses faiblesses, elle demeure convaincue que le temps travaille pour elle » écrit-il p. 72. La Chine demeure cette immense nation qui a brillé sur l’humanité jusqu’à la Renaissance. Elle invente l’imprimerie bien avant que Gutenberg le fasse pour l’occident, la monnaie fiduciaire, la poudre etc… Si l’inertie bureaucratique a toujours été le talon d’Achille de ce géant, la Chine demeure riche d’une histoire millénaire qu’aucune autre nation moderne ne peut lui opposer.
« Si la confiance de la Chine est largement fondée sur son passé, celle de l’Inde l’est sur sa vision du futur » écrit-il p. 85. Ce renouveau est liée à l’indépendance encore récente de l’Inde (60 ans). Comme la Chine, mais pour des raisons différentes, l’Inde possède ses contradictions internes (fortes inégalités, système des castes, corruption etc…). Mais citant Pavan K. Varma dans Le défi indien, il écrit que « un étranger ne pourra jamais comprendre à quel point un indien est mentalement préparé à accepter l’inacceptable ». Pour Varma et Moïsi, tant que les marginaux auront foi dans leur avenir, l’espoir prévaudra en Inde.
Les Etats-Unis sont l’autre grande nation qui vient de basculer dans l’espoir avec la récente élection de Barack Obama. Quelle nation incroyable ! Comme l’écrivait Pascal à propos de l’homme, elles sont capables du meilleur et comme du pire. Cela est sans doute vrai de toute nation, mais la particularité des Etats-Unis est leur si rapide versatilité. Si la Chine se caractérise par une grande inertie, les Etats-Unis sont de ce point de vue leur exact opposé. Cette jeune nation, après avoir quasiment exterminé tous les amérindiens natifs du continent, produit les penseurs les plus originaux du XIXème siècle avec Emerson, Thoreau ou Whitman. Aujourd’hui, après une quinzaine d’années sous l’émotion dominante de la peur, les Etats-Unis font un virage à 180° vers l’espoir.
L’humiliation
Deuxième émotion clé repérée par Dominique Moïsi, l’humiliation est la confiance bafouée, dont le degré est d’autant plus fort que cette confiance est trahie par quelqu’un qui nous paraissait fiable. Pour Moïsi, les civilisations musulmanes sont actuellement à dominante d’humiliation. La civilisation musulmane a connu une extension foudroyante depuis les premiers siècles de l’Hégire. Elle s’est étendue de la péninsule arabique vers l’Europe, l’Asie et l’Afrique, imposant par l’épée une nouvelle religion, mais pas uniquement. L’Islam proposait aussi un modèle de civilisation raffinée qui supplantait à bien des égards les cultures locales envahies. Sans cela, ces conquêtes auraient été sans lendemain. Mais le XVIIIème siècle marque un arrêt des conquêtes musulmanes. Le continent américain reste largement hors de sa sphère d’influence. Le monde anglo-saxon est principalement chrétien à dominante protestante.
L’Islam peine à entrer dans la modernité. Moïsi écrit p. 97 « si l’espoir est confiance, l’humiliation est impuissance ». Mais notre auteur prend garde de ne pas faire d’amalgame, « Il n’est pas possible de parler de l’Islam comme d’une entité. Il s’est diffracté en de multiples incarnations, comprenant diverses variations religieuses, culturelles, nationales et politiques […]. En outre, le monde arabe lui-même n’existe pas vraiment en tant que tel. Il est composé de différentes nations unies par un sentiment commun d’insécurité. » (pp. 99-100).
Pour Moïsi, ce déclin de civilisation que connaît l’Islam s’amorce dès la Renaissance européenne. Mais il est renforcé par certains événements du XXème comme la création de l’Etat d’Israël. Cet événement est vécu par les palestiniens et le monde musulman en général comme « son incapacité à écrire lui-même son histoire » (p. 108). La guerre des Six Jours en 1967 est également un événement important qui brise « les ambitions nationalistes arabes du président Nasser » en Egypte (p. 109).
Au final l’analyse de Moïsi met en lumière le rôle de l’humiliation comme « arme diplomatique » et bien sûr son rôle important comme ferment du terrorisme.
La peur
Troisième et dernière émotion analysée par Dominique Moïsi, la peur. Elle est caractérisée pour Moïsi par un sentiment de perte d’identité, de « crise d’identité ». « La peur est une réponse émotionnelle à la perception d’un danger imminent, réel ou exagéré » (p. 148).
L’Europe est à bien des égards une représentante emblématique de cette émotion. La question fondamentale qui la taraude est, pour Moïsi, la suivante : « Qui sommes nous ? ». Le XXème siècle marque sans conteste la fin de sa récente hégémonie dans l’histoire de l’humanité. La guerre de 1914-1918, parfois qualifié de « suicide de l’Europe » et relayé par le déchainement de nos appétits de destruction systématique de l’humain avec la guerre de 1939-1945. Malgré l’émergence du rêve européen dans les années 50 et sa construction réussie jusque dans les années 1990, force est de constater que la réalité européenne reste largement abstraite.
Les Etats-Unis ont vécu et vivent encore actuellement dans une culture où la peur est dominante. L’élection de Barack Obama est à cet égard un retournement spectaculaire de cette émotion. Un immense espoir est à l’œuvre actuellement qui supplante cette ancienne peur.
Le Japon est également un pays qui selon Moïsi est sous l’emprise de cette émotion dominante. Mais les raisons sont en partie différentes. Au Japon on rencontre le respect et la crainte de la nature. Alors qu’ici nous craignons de saccager la nature, au pays du soleil levant, chacun sait que la nature est victorieuse parce qu’elle est le substrat de toute vie. Néanmoins comme en Europe la population du Japon est vieillissante. De même les entreprises, bien que dynamiques, connaissent des travailleurs angoissés, stressés ou déprimés. Et puis la Chine, concurrent historique du Japon est perçu comme une menace.
Les pays inclassables
Dominique Moïsi repère un certain nombre de pays inclassables. La grille de lecture « émotionnelle » qu’il a mis en place tout au long de son livre n’y est pas inopérante, mais plutôt il repère dans ses pays une palette émotionnelle plus équilibrée que dans ceux analysés précédemment. C’est le cas de la Russie et de l’Iran où se rencontrent les trois émotions également réparties. C’est également le cas d’Israël qui oscille entre l’espoir et la peur. Enfin les pays qui composent l’Afrique et l’Amérique du sud ne sont pas sous une dominante émotionnelle aisément repérable.
Au final, Dominique Moïsi trace une nouvelle carte du monde où les territoires sont représentés par leur couleur émotionnelle. Il ne franchit pas le pas de la dessiner effectivement. N’étant pas un spécialiste de la géopolitique, l’analyse et le résumé que je fournis du travail de Moïsi ne prétend pas être « profonde ». En revanche, outre ce travail de pionnier qui ne peut manquer de comporter de nombreuses imprécisions, tout le mérite que je reconnais à Dominique Moïsi est d’offrir à son lecteur :
- une analyse claire, simple et respectueuse des motivations des pays, de leur histoire récente et de la manière dont ils envisagent leur avenir,
- de proposer une piste de réflexion nouvelle qui devrait être approfondie par d’autres auteurs.
Dominique Moïsi, La géopolitique de l’émotion, Flammarion, 9782081208148, 20€.
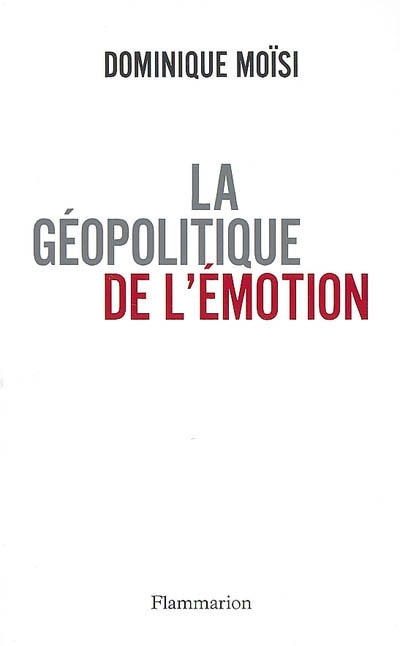
Un livre à découvrir pour regarder le monde différemment
