La logique de sous-système de la sphère économique (dans le système plus global de la biosphère) interfère avec des logiques de régulation plus vastes. La biosphère se caractérise par un jeu complexe de réserves et de régulations renforcé par un double mouvement de diversification et de complexification propre à l’évolution.
C’est Claude Bernard qui le premier mit en évidence le jeu des réserves et des régulations. Les réserves permettent de répondre aux imprévus, mais elles nécessitent l’existence d’un système de régulation en mesure de faire appel à elles à chaque fois que le système s’éloigne d’une valeur normale. Ce retour à la valeur normale est un feed-back compensateur typique des phénomènes d’homéostasie. Ce couplage réserves/régulation assure la pérennité du système.
Le mouvement de diversification et de complexification renforce ce couplage. Il existe une microévolution spécialisante qui produit une adaptation plus pointue aux différents milieux. Parallèlement une macroévolution complexifiante située au niveau des groupes classificatoires supérieurs se traduit par le développement du système nerveux et des organes sensoriels. Cette macroévolution complexifiante aboutie à trois sortes de stabilité étudiée par William Ross Ashby (1903-1972):
- une stabilité simple ou le système réagit à des perturbations limitées;
- une ultrastabilité, aptitude du système à réagir à des perturbations trop fortes ou trop fréquentes en changeant le type de réaction et en créant de nouveaux mécanismes de corrections;
- une multistabilité, assemblage de systèmes ultrasables relativement indépendants les uns des autres, qui s’activent indépendamment, capable d’automodification et d’habituation.
Le principe d’efficacité à l’œuvre dans la nature qui tend à optimiser le rapport flux d’énergie/biomasse se retrouve aussi en économie avec l’optimisation du rapport flux/stock. Pourtant l’efficacité obéit dans chacun des cas à des critères radicalement opposés.
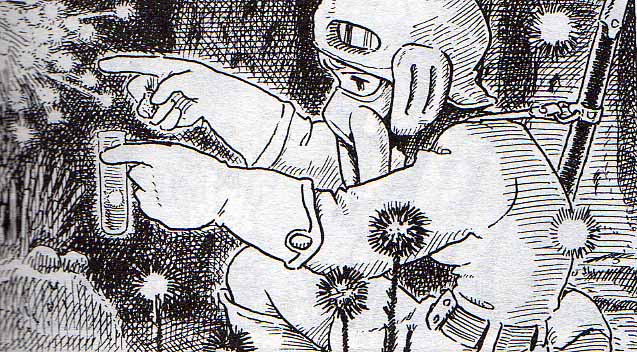
2.3.1/ L’environnement, bien collectif soumis à une logique de gestion privée
Soumettre un bien collectif à la gestion privée revient à subordonner l’intérêt commun au jeu d’intérêts particuliers et à substituer subrepticement ce qu’on appelle en économie une fonction d’utilité individuelle à une fonction d’utilité sociale. En économie néoclassique, chaque agent, individuel ou collectif, peut être défini par une fonction d’utilité qui caractérise ses préférences et donc le comportement qu’il va adopter. Cette approche en terme de fonction d’utilité est dépendante de la philosophie morale et politique anglo-saxonne appelée «utilitarisme» qui, pour l’expliquer rapidement, considère que toute action d’un sujet (individuel ou collectif) est mue par son intérêt (pas seulement égoïste, cet intérêt peux se révéler plein de compassion, mais cette voie a rarement été explorer par les sciences économiques). Cette approche en terme de fonction d’utilité possède l’avantage d’être en partie formalisable mathématiquement, donnant ainsi aux sciences économique un cachet de scientificité qu’elle envie aux sciences de la nature. En revanche elle simplifie à outrance la palette des comportements humains, s’interdisant souvent de comprendre les mobiles de l’action. Enfin, elle adopte un présupposé discutable, le fait que les comportements collectifs puissent se retrouver en agrégeant des comportements individuels.
Les biens collectifs comme l’eau ou les espèces vivantes sont source de richesses immatériels dans le sens où ces richesses s’obtiennent par participation, nous sommes ici plutôt dans le domaine de l’être. Mais ces biens collectifs peuvent être aussi sources de richesses matérielles auquel cas nous sommes dans le domaine de l’appropriation, de l’avoir. Dans le premier cas il est impossible de valoriser la richesse par un système de prix. Or la science économique ne peut traiter que des prix. Aussi elle s’efforce de transformer les biens collectifs en valeur marchande, ils deviennent des produits qui s’échangent sur un marché. L’économie introduit donc dans la biosphère un type de relations bien particulières.
2.3.2/ Causalité linéaire contre interdépendance et circularité
La biosphère est animée par l’énergie solaire. À partir de cet apport énergétique primordial, la vie opère un bouclage qui lui permet de générer de nouvelles réserves organiques à partir de ses déchets. Ce mouvement circulaire se retrouve tant au niveau de l’inanimé que du vivant.
La vie se construit à partir de six éléments chimiques de base:
- le carbone,
- l’hydrogène,
- l’oxygène,
- l’azote,
- le soufre,
- et le phosphore.
Ces éléments circulent dans les grands réservoirs que sont
- l’atmosphère,
- l’hydrosphère,
- la biosphère (ici entendue comme la biomasse),
- et la lithosphère (sédiments).
Ces réservoirs sont comme la mémoire de l’écosystème qui reproduisent un état de constance du milieu. Cette constance n’est valable que dans une certaine limite de variations. Ces phénomènes de limites, qui assurent la pérennité du système, échappent à la logique de l’économie. Jusqu’à aujourd’hui, les sciences économiques ne les intègrent pas dans leurs analyses.
Au niveau du vivant il est possible de repérer deux interdépendances primordiales:
- les relations des espèces avec le milieu,
- et les relations des vivants entre eux (synécologie).
La synécologie est la branche de l’écologie qui étudie les relations entre les vivants de la coopération à la prédation. Quand rien ne trouble un écosystème, il établit un équilibre entre tous ses éléments qu’on appelle le climax, caractérisé par un rendement élevé des flux énergétiques qui le parcourent.
Si les réflexions économiques prennent en compte l’interdépendance et éventuellement les rétroactions, elles ne le font que dans les limites du jeu des facteurs économiques, sans prendre en compte les effets externes négatifs de la logique économique sur le milieu dans lequel elle s’insère.
Les deux conséquences de cette logique économique au niveau des prélèvements sur les écosystèmes est la maximisation des flux et la rupture des stocks. Les réflexions économiques n’appliquent leurs analyses de variation de stocks et d’amortissement au seul facteur technique, sans comptabiliser l’épuisement des ressources naturelles ou la dégradation de la ressource humaine. N’est gérée que la maximisation des flux financiers. Du coup, certaines ressources s’épuisent plus vite que leur capacité de reconstitution. Par exemple, A. et P. Ehrlich affirment que l’homme, par le biais des industries agro-alimentaires et du secteur de la chimie-parachimie, fait disparaître l’eau douce plus rapidement que le cycle hydrologique ne peut la remplacer.
La conséquence de la logique économique au niveau des rejets est la rupture des régulations bio-géo-chimiques. Cette rupture des grands cycles bio-géo-chimiques est lié à l’accroissement massif d’un de ces éléments, ou à l’introduction d’un élément qui lui est étranger. Ainsi avec l’utilisation intensive des pesticides, ces produits chimiques se retrouvent dans toutes la chaîne alimentaire du fait de l’interdépendance générale des écosystèmes.
2.3.3/ Les conflits des rythmes
En plus d’être causal et linéaire, le temps économique est également bref et contracté en comparaison du temps écologique. La durée du cycle du carbone est évaluée par exemple entre quatre et dix siècles. Un principe de réalisme voudrait que lorsqu’une activité humaine se trouve en présence de plusieurs rythmes, se soit le plus lent qui gouverne la marche de cette activité sous peine de rupture des grands cycles de régulation. Or en économie, la recherche de la maximisation du profit et les calcul d’actualisation poussent au contraire à intensifier les activités qui tirent du milieu le maximum de rendement en un minimum de temps. Plus le taux d’actualisation est élevé et plus la période durant laquelle un investissement livrera l’essentiel de ses résultats est courte. Le taux d’actualisation est lié à la productivité du capital, il devient donc rationnel d’un point de vue économique d’intensifier l’exploitation des ressources dans le présent.
Au niveau humain, force est de constater que le rythme de la machine s’impose au travail humain. Comme la productivité du capital, la productivité du travail est privilégiée. Cette course, attisée par la compétition internationale dans un contexte de libéralisation des échanges et de déréglementation, induit une substitution de la machine au travail humain. Le travail humain devient un facteur d’ajustement, avec ce que cela implique comme exclusion sociale et comme précarité. La structure des rythme de la machine n’est pas une structure identique à celle que nous rencontrons dans les rythmes biologiques. La machine ne connaît pas de cycle nocture/diurne par exemple, d’où la possibilité de travailler la nuit. Le rythme humain est gouverné par des synchroniseurs écologiques, d’autres plus superficiels sont d’ordre sociologique et enfin les derniers sont d’ordre économique. L’homme ne peut se soumettre durablement au seul synchroniseur économique sans risque sérieux pour sa santé. Comme l’écrit Wisner, on ne peut proposer une compensation financière à des pratiques qui détruisent celui qui s’y prête.
2.3.4/ Simplification des écosystèmes contre stabilité
Un écosystème ne peut se reproduire dans le temps que s’il comporte suffisamment de diversité. Cette loi se vérifie tant au niveau individuel qu’au niveau de la population. Dès 1955 Robert Mac Arthur a formulé une loi mettant en évidence la relation étroite entre la stabilité d’un écosystème et le nombre de mailles qui le constituent.
De nouveau sur ce point la logique économique du rendement conduit à un résultat opposé: la sélection et la spécialisation. L’uniformisation génétique est dangereuse pour cette raison. Plus adaptée à une type particulier d’environnement, cette uniformisation signe l’extinction d’une population en cas de variation du milieu (nouvelles contraintes écologiques, nouveaux virus etc…). A titre d’exemple, au néolithique, l’homme utilisait environ 100000 espèces végétales comestibles, aujourd’hui l’espèce humaine ne cultive plus que 150 espèces environ, et la majorité de l’humanité ne vit que de 12 espèces. D’ailleurs plus important que de collectionner des espèces, c’est l’interaction entre les espèces qu’il convient de maintenir, comme les mailles d’un tissu.
2.3.5/ Le jeu combiné de ces facteurs

Deux logiques opposées sont donc à l’œuvre. D’une part la biosphère, notre habitat, le substrat sur lequel s’appuie une autre logique qui lui est en partie antinomique: l’économie. La solution se trouve dans notre capacité à adopter une vision d’ensemble. Puisque l’activité économique trouve son origine et son aboutissement dans la biosphère, la science économique doit être en mesure de dégager les lois capables d’éclairer les décisions et d’intégrer les phénomènes de la biosphère et les phénomènes économiques dans une même vision d’ensemble. Une approche bio-économique…
